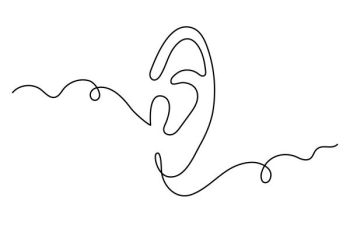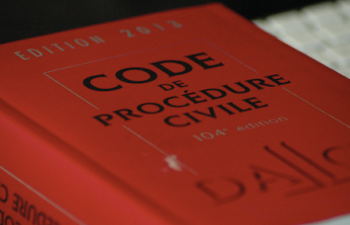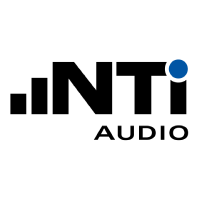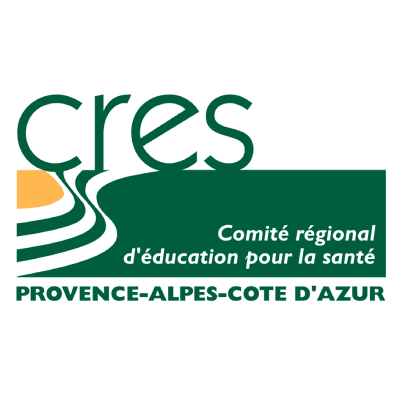Nous vous souhaitons une bonne fin d'année !
2.15.0.0
2.15.0.0
2.15.0.0
Le CidB rouvrira ses portes le lundi 6 janvier.
Nos actions
Nos ressources
Les chiffres du bruit
147
C'est le coût social du bruit en France
(Etude Ademe/CNB 2021)
1
de jeunes dans le monde sont soumis à un risque de perte auditive
(OMS, 2022)
70
des étudiants sont gênés par le bruit dans leur logement
(Union étudiante, 2023)
A la une